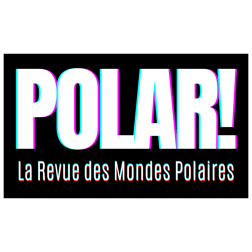Christophe-André Frassa: un sénateur polaire
Les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) occupent une place stratégique et sensible dans le concert des nations, au croisement de la diplomatie internationale, des enjeux environnementaux et des intérêts économiques. Dans cet entretien, Christophe-André Frassa, sénateur et président du groupe d’étude “Arctique, Antarctique et Terres Australes” au Sénat, nous livre une analyse approfondie des défis actuels qui marquent ces territoires d’exception. De la préservation de l’écosystème fragile de l’Antarctique à l’évolution des tensions internationales, cette interview dévoile des perspectives inédites sur l’avenir des TAAF et leur rôle dans la diplomatie et la sécurité mondiale.
INTERVIEW
12/28/202415 min read
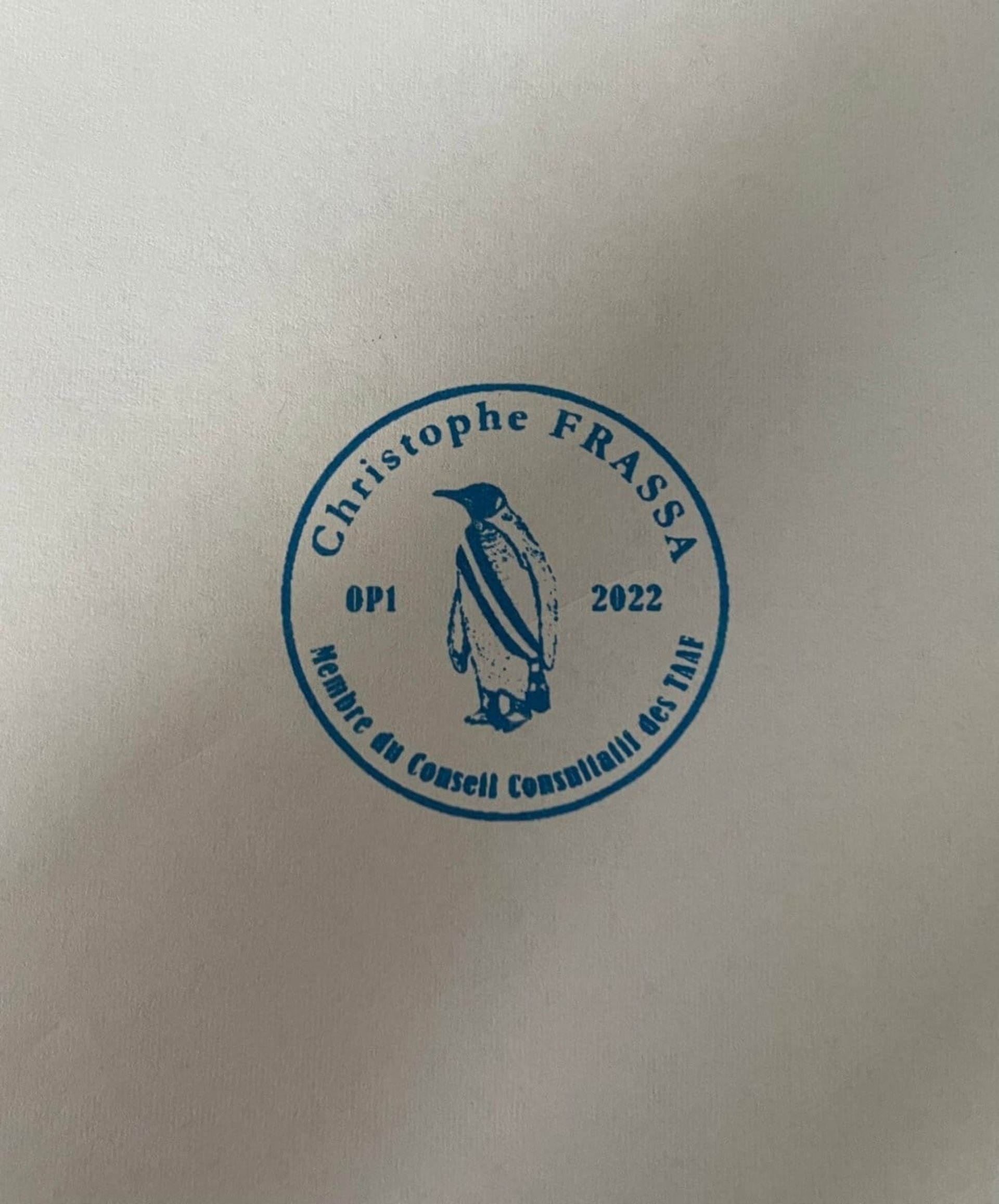
Christophe-André Frassa: un sénateur polaire
Crédits photos: © Christophe-André Frassa
Les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) occupent une place stratégique et sensible dans le concert des nations, au croisement de la diplomatie internationale, des enjeux environnementaux et des intérêts économiques. Dans cet entretien, Christophe-André Frassa, sénateur et président du groupe d’étude “Arctique, Antarctique et Terres Australes” au Sénat, nous livre une analyse approfondie des défis actuels qui marquent ces territoires d’exception. De la préservation de l’écosystème fragile de l’Antarctique à l’évolution des tensions internationales, cette interview dévoile des perspectives inédites sur l’avenir des TAAF et leur rôle dans la diplomatie et la sécurité mondiale.
Vous êtes aujourd’hui président du groupe d’études "Arctique, Antarctique et Terres Australes" au Sénat. Pouvez-vous nous raconter votre parcours jusqu’à ce rôle ?
Bien sûr. Mon prédécesseur était Christian Cointat, sénateur des Français de l’étranger, qui présidait ce groupe jusqu’en 2014. Lorsqu’il a décidé de ne pas se représenter, j’étais déjà membre de ce groupe d’études, et j’ai exprimé mon souhait de lui succéder. C’est ainsi que j’ai pris la présidence. Ce poste inclut également une nomination au conseil consultatif des Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF). Pour moi, c’était un rêve d’enfant qui devenait réalité.
Un rêve d’enfant, dites-vous ?
Oui, tout à fait. J’ai toujours rêvé de découvrir ces îles reculées, presque inaccessibles, où seuls quelques chercheurs séjournent brièvement. Malgré tous les documentaires et photos que l’on peut voir, l’expérience sur place est indescriptible. Ces paysages préservés donnent l’impression de revenir 25 000 ans en arrière, à une époque où la nature était intacte. Il y a encore des zones entières de ces archipels où personne n’a jamais mis les pieds, et c’est fascinant.
Avez-vous eu l’occasion d’explorer ces lieux inédits ?
Oui, par exemple, lors d’une marche de 25 kilomètres sur un sol instable, en bottes de caoutchouc. Ce terrain est si vierge que rien n’est stabilisé : les moraines fondent, les roches roulent comme des galets, et l’on se dit que l’on est peut-être la première personne à marcher ici depuis des millénaires. C’est un sentiment unique.
La préservation de ces écosystèmes est un défi majeur. Quels efforts sont déployés dans ce sens ?
La prise de conscience de la fragilité de ces territoires est récente, et nous avons mis en place des mesures strictes pour protéger ces milieux. Cela passe par un contrôle rigoureux des espèces invasives, qu’elles soient animales ou végétales. Par exemple, lors de mes visites, j’ai suivi des procédures strictes de décontamination : nettoyer mes bottes, mes vêtements, et même les provisions, pour éviter d’introduire des graines ou des insectes non natifs.
Malgré ces efforts, les impacts passés de l’homme sur ces territoires restent visibles.
Absolument. Prenez les chats, les rats ou les lapins, introduits par des marins ou des chercheurs dans les décennies passées. Ces espèces, qui n’ont rien à voir avec les écosystèmes locaux, ont eu des effets dévastateurs. Les chats, par exemple, sont devenus des prédateurs redoutables. J’ai vu de mes propres yeux un chat sauvage attraper et déchiqueter un lapin avec la violence d’un félin sauvage. Ces animaux menacent directement des espèces fragiles comme l’albatros d’Amsterdam, dont les œufs et les petits sont attaqués par les rats.
”Certains prônent une interdiction totale, mais ces territoires ont aussi une dimension scientifique et stratégique. Nous devons concilier recherche, observation, et préservation.”
Quelles solutions sont mises en place pour remédier à ces déséquilibres ?
Nous avons mené des campagnes d’éradication, comme l’élimination des rats sur l’île d’Amsterdam. Ces opérations nécessitent des moyens considérables : hélicoptères, personnels spécialisés, et un investissement financier important. Mais c’est essentiel pour restaurer ces écosystèmes uniques.
Pensez-vous qu’il faut limiter davantage la présence humaine dans ces territoires ?
C’est un équilibre à trouver. Certains prônent une interdiction totale, mais ces territoires ont aussi une dimension scientifique et stratégique. Nous devons concilier recherche, observation, et préservation. Par exemple, l’île de l’Est, dans l’archipel de Crozet, est désormais une réserve stricte, inaccessible à l’homme. Mais nous ne pouvons pas exclure totalement la recherche, qui est cruciale pour comprendre ces écosystèmes et les bouleversements climatiques en cours.
Justement, quelle est votre position sur le tourisme dans ces régions ?
Je suis très réservé, notamment pour l’Antarctique. Certaines croisières, sous couvert de démarches scientifiques, fracturent la banquise pour accéder à des zones reculées. Cela me révolte dans un contexte de changement climatique. Ces expéditions commerciales vont à l’encontre de l’esprit du traité de l’Antarctique, qui vise à préserver ce continent unique.
Et pour les TAAF ?
C’est différent. Les conditions d’accès et de navigation rendent le tourisme presque impossible, ce qui est une bonne chose. Ces territoires doivent rester des lieux de recherche et de préservation, et non des destinations de loisir.


Lorsqu'on parle des terres australes, on imagine souvent des lieux inaccessibles. Pourtant, ces territoires ont une importance géopolitique et écologique capitale. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Oui, c’est exact, ces îles sont isolées, et en effet, il n'y a même pas de quai pour accoster dans certains endroits. Ce n'est pas un lieu où l’on va pour le tourisme de masse. L'objectif n’est pas de créer un lieu d’attraction, comme un parc d'attractions. Une fois qu'on a vu Montrose ou les sites à proximité, je doute que la vie des gens change fondamentalement. Mais l’enjeu est ailleurs : il concerne surtout des écosystèmes très fragiles, comme ceux des îles du canal de Mozambique. Certaines de ces îles sont menacées par la montée des eaux, et certains atolls disparaissent lors des grandes marées. L’impact du changement climatique y est déjà très visible. Il faut donc faire attention à ne pas transformer ces zones sensibles en terrains de loisirs, comme la mangrove par exemple, où l’écosystème est particulièrement vulnérable.
Vous évoquez la fragilité de l'écosystème, mais aussi des tensions géopolitiques. Cela ne complique-t-il pas encore plus la gestion de ces îles ?
Bien sûr, c’est un aspect qu’il ne faut pas négliger. Ces îles sont parfois l’objet de revendications illégitimes de certains pays. Les zones trop proches de la mer, comme les îles du canal de Mozambique, font l’objet de tensions qui ne sont pas toujours visibles sur le plan diplomatique, mais qui existent bel et bien. Cela reste donc un territoire qu'il faut protéger et gérer avec beaucoup de discernement. Notre priorité, à ce titre, est de maintenir ces zones comme des sanctuaires pour la biodiversité. Certes, on comprend que dans un monde de plus en plus friand de sensations fortes, il y ait des tentatives pour offrir de nouvelles attractions, mais ce n’est pas la vocation des TAAF. Ces îles sont avant tout un espace de protection scientifique.
”La pêche est un enjeu majeur, à la fois économique et stratégique. Il y a des espèces emblématiques comme le thon, la légine, ou la langouste d'Amsterdam.”
Et du point de vue du grand public, comment susciter de l’intérêt pour ces territoires ? Est-ce un défi pour vous ?
Oui, cela reste un défi. Beaucoup ignorent même l’existence de ces territoires. Quand on parle de Kerguelen, il y a un déclic, mais très peu savent réellement où elles se trouvent sur une carte. D’ailleurs, quand on parle de l’Océan Indien, les gens imaginent immédiatement des plages de sable fin, de cocotiers et des eaux chaudes. Pourtant, à Kerguelen, la température de l’eau ne dépasse jamais les 7 degrés, même en plein été. L’avantage, c’est que cette collectivité ne coûte pas cher. Elle a des droits de pêche qui génèrent des ressources, mais son administration reste minimaliste et très bien gérée. Et pour capter l’attention, nous avons une approche astucieuse, notamment avec la philatélie. Les timbres des TAAF ont une grande valeur pour les collectionneurs et suscitent un intérêt inattendu, notamment auprès des enfants et des philatélistes. C’est un moyen d’attirer l’attention, même si ces îles restent des zones éloignées.
Vous évoquez la pêche. Quelle place occupe cette activité économique dans l’économie des TAAF ?
La pêche est un enjeu majeur, à la fois économique et stratégique. Il y a des espèces emblématiques comme le thon, la légine, ou la langouste d'Amsterdam. La zone 57, celle des TAAF, est particulièrement riche en ressources, mais bien peu en connaissent les enjeux. Tout le monde parle des thons du Pacifique, mais personne ne parle de ceux des TAAF, qui sont pourtant d’une qualité irréprochable. C’est une zone de pêche exclusive, qui génère des ressources significatives via des licences de pêche. Malheureusement, la majorité de la pêche part en Asie, et nous en bénéficions peu. Cependant, ces ressources rapportent de l’argent à l'État français et sont gérées de manière raisonnée. La pêche raisonnée est faite en concertation avec plusieurs ministères pour préserver les stocks tout en maximisant les bénéfices.
L’intérêt pour les TAAF semble croissant au sein du Sénat, mais est-ce facile de faire entendre la voix de ces territoires dans un contexte géopolitique complexe ?
C’est un travail constant. Au Sénat, nous avons constitué un groupe d’étude sur les TAAF. Il regroupe des sénateurs de divers départements et de différentes sensibilités. Nous avons tous conscience de l'importance géopolitique et stratégique de ces territoires, surtout dans le cadre de la stratégie Indo-Pacifique. Ces territoires font partie de la plus grande zone économique exclusive (ZEE) au monde, et leur gestion est essentielle. Ils représentent des enjeux de souveraineté militaire et de sécurité maritime. Il y a donc une mobilisation croissante au sein du groupe pour défendre ces intérêts, notamment vis-à-vis de la pêche illégale et des problématiques de sécurité dans cette zone. Mais, bien entendu, les moyens restent toujours insuffisants au regard de la taille de la zone, ce qui nécessite un suivi constant, en particulier via des moyens technologiques comme les satellites.


Vous mentionnez les enjeux liés au réchauffement climatique. De quelle manière ces changements affectent-ils les Terres australes et leurs écosystèmes ?
Le changement climatique affecte directement ces territoires. Nous assistons à des phénomènes de montée des eaux, mais aussi à des transformations de la flore, qui subit les impacts du réchauffement. De plus, des détachements d’icebergs, plus au nord que prévu, commencent à devenir visibles, comme lors de notre opération en 2022, où un iceberg de taille conséquente a été observé à proximité des îles Crozet. Ces phénomènes sont préoccupants. En Antarctique, la fonte des glaces pourrait avoir des répercussions majeures sur les territoires voisins et, à plus long terme, sur la géopolitique mondiale.
Le réchauffement climatique va-t-il entraîner des bouleversements géopolitiques, notamment en Arctique et en Antarctique ?
L’Arctique, à court terme, pourrait être plus touchée, avec la disparition de la glace durant la saison estivale. Cela crée de nouveaux passages maritimes, et certains pays pourraient voir une opportunité économique dans l’exploitation de ces routes maritimes. En ce qui concerne l’Antarctique, le traité qui gèle les prétentions territoriales est essentiel, mais il pourrait être menacé. Certains États, face à la crise économique, pourraient chercher à exploiter les ressources de l'Antarctique. Il est donc crucial de maintenir une pression diplomatique pour garantir le respect du traité et éviter que des intérêts économiques n’entraînent des dérives. La France, à travers des discussions avec des experts comme Olivier Poivre d'Arvor, l’ambassadeur pour les pôles, travaille activement à éviter cette dérive, en misant sur une coopération intelligente entre les pays de bonne volonté pour préserver l'esprit du traité.
Et en ce qui concerne la recherche polaire, comment évoluent les conditions et les enjeux de la recherche scientifique dans ces territoires ?
La recherche scientifique dans les TAAF est une priorité. Chaque année, environ 150 à 200 scientifiques se rendent dans ces territoires pour mener des travaux de recherche. Cela engendre des coûts logistiques considérables, car les conditions sont extrêmes. Mais cette recherche a une valeur stratégique immense, notamment pour comprendre l'impact du réchauffement climatique. Les scientifiques jouent un rôle clé dans la collecte de données précieuses, mais il faut aussi des moyens conséquents pour soutenir ces missions. La France reste l'un des acteurs majeurs dans la recherche polaire, avec des bases comme celle du Mont d'Urville en Antarctique, qui nécessitent des investissements constants pour leur entretien et leur mise à jour.
Il y a souvent des discussions sur la durée des séjours en Antarctique et dans les Terres Australes. Vous évoquez la difficulté pour certains chercheurs de prolonger leur séjour à cause des coûts associés. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Oui, c’est une vraie problématique. Les scientifiques aimeraient parfois rester plus longtemps, mais c'est le coût des rotations et des séjours qui impose une limite. Lors de ma propre expérience sur l’opération à laquelle j'ai participé, j’ai échangé avec des scientifiques qui, bien que passionnés, auraient voulu prolonger leur séjour. Malheureusement, la réalité économique des universités les contraint à limiter la durée de leurs missions. Il y a plusieurs coûts à prendre en compte : l’envoi des chercheurs à la Réunion, la rotation des équipes, et puis le séjour lui-même. C’est un budget qui n’est pas toujours facile à boucler.


La gestion de ces coûts semble donc cruciale pour l’administration des TAAF. Pensez-vous que la recherche polaire parviendra à se faire entendre dans le contexte actuel de restrictions budgétaires ?
C'est une lutte constante. Chaque année, l'IPEV (Institut polaire français Paul-Émile Victor) doit faire appel à la solidarité des parlementaires, ceux qui sont sensibles à la cause polaire, pour tenter de sauver une partie de son budget. Nous essayons de récupérer des fonds, même modestes, pour que l’IPEV puisse continuer ses missions. Il est difficile de se faire entendre dans un contexte où tous les secteurs cherchent à réduire leurs dépenses, alors que des pays comme les États-Unis ou le Royaume-Uni priorisent de plus en plus la recherche polaire. En France, la hiérarchisation des priorités n’est pas évidente.
Et au sein du groupe d’étude sur l'Arctique, l’Antarctique et les Terres australes, réussissez-vous à obtenir un consensus sur ces enjeux ?
Oui, c’est un avantage d’avoir un groupe transpartisan. Il y a des sénateurs de tous les horizons politiques. Quand on parle de la cause des TAAF, tout le monde s'accorde à défendre cette recherche, peu importe les divergences sur d’autres sujets. Il y a un réel consensus sur l'importance des enjeux liés aux pôles. Nous essayons également de plaider notre cause en amont auprès des cabinets ministériels, en leur expliquant que ce que nous demandons n’est pas une grande somme, mais qu’elle est essentielle pour la poursuite de la recherche.
”À Crozet, c’est très violent. La base est en surplomb, et on est immédiatement entouré par une manchotière et une tourbière. Le climat y est difficile, avec des vents violents et des conditions souvent extrêmes.”
Vous parlez de sensibilisation du grand public. Est-ce que l’éducation, notamment dans les écoles, est un bon levier pour cela ?
Absolument. Dans les écoles, quand on évoque des sujets comme les manchots ou les albatros, les enfants sont fascinés. Mais c’est vrai que pour les étudiants universitaires, la recherche polaire reste souvent une niche. C’est un secteur très spécifique, attirant uniquement les passionnés. Les jeunes qui partent dans les réserves naturelles, comme agents de la réserve ou en tant qu’étudiants en ornithologie ou en biologie, sont des passionnés qui se battent pour pouvoir participer à ces missions.
Et concernant la communication autour de la recherche polaire, que pourrait-on améliorer pour la rendre plus visible ?
Il y a une grande production scientifique, mais elle n'est pas suffisamment identifiée sous un seul vocable. On parle souvent des travaux du MNHM (Muséum National d'Histoire Naturelle) ou du CNRS, mais on ne parle pas des recherches en TAAF sous un terme global. Chaque institution aime garder son identité. Cela complique la visibilité de la recherche polaire, même si ceux qui cherchent vraiment trouvent facilement les informations. Il y a un problème d’identification sous une seule bannière, ce qui pourrait être amélioré.
Vous avez beaucoup voyagé, y compris dans les TAAF.
Oui, j’ai eu la chance de visiter plusieurs terres australes comme Crozet, Kerguelen, Amsterdam, et Saint-Paul. Mon premier voyage en rotation avec le Marion Dufresne a été un véritable moment de découverte. C’était un voyage dans la plus pure tradition des grandes épopées, comme celles du XVIIIe siècle, où chaque moment du trajet fait partie du voyage. Le cadre, l’aventure humaine à bord, les échanges avec les jeunes qui m'accompagnaient, c’était exceptionnel.
Parlez-nous de votre expérience à Crozet et Kerguelen. Que pouvez-vous nous en dire ?
À Crozet, c’est très violent. La base est en surplomb, et on est immédiatement entouré par une manchotière et une tourbière. Le climat y est difficile, avec des vents violents et des conditions souvent extrêmes. À Crozet, il est essentiel d’être en bonne condition physique. Pour l’anecdote, je me suis retrouvé plaqué contre un mur par une tempête alors que j'étais tout équipé pour affronter ces conditions. C’était un vrai défi physique et mental. À Kerguelen, le climat est également impitoyable, et les conditions de vie sont rudes, mais la beauté et l'isolement de l’endroit en font un lieu unique. J’ai eu l’occasion de rencontrer des personnes fascinantes, comme un Martiniquais qui faisait sa septième mission là-bas, un vrai passionné du froid. C’est ce genre d’expérience humaine qui rend ces endroits uniques.


Vous parlez de sensibilisation du grand public. Est-ce que l’éducation, notamment dans les écoles, est un bon levier pour cela ?
Absolument. Dans les écoles, quand on évoque des sujets comme les manchots ou les albatros, les enfants sont fascinés. Mais c’est vrai que pour les étudiants universitaires, la recherche polaire reste souvent une niche. C’est un secteur très spécifique, attirant uniquement les passionnés. Les jeunes qui partent dans les réserves naturelles, comme agents de la réserve ou en tant qu’étudiants en ornithologie ou en biologie, sont des passionnés qui se battent pour pouvoir participer à ces missions.
Et concernant la communication autour de la recherche polaire, que pourrait-on améliorer pour la rendre plus visible ?
Il y a une grande production scientifique, mais elle n'est pas suffisamment identifiée sous un seul vocable. On parle souvent des travaux du MNHM (Muséum National d'Histoire Naturelle) ou du CNRS, mais on ne parle pas des recherches en TAAF sous un terme global. Chaque institution aime garder son identité. Cela complique la visibilité de la recherche polaire, même si ceux qui cherchent vraiment trouvent facilement les informations. Il y a un problème d’identification sous une seule bannière, ce qui pourrait être amélioré.
Vous avez beaucoup voyagé, y compris dans les TAAF.
Oui, j’ai eu la chance de visiter plusieurs terres australes comme Crozet, Kerguelen, Amsterdam, et Saint-Paul. Mon premier voyage en rotation avec le Marion Dufresne a été un véritable moment de découverte. C’était un voyage dans la plus pure tradition des grandes épopées, comme celles du XVIIIe siècle, où chaque moment du trajet fait partie du voyage. Le cadre, l’aventure humaine à bord, les échanges avec les jeunes qui m'accompagnaient, c’était exceptionnel.
Parlez-nous de votre expérience à Crozet et Kerguelen. Que pouvez-vous nous en dire ?
À Crozet, c’est très violent. La base est en surplomb, et on est immédiatement entouré par une manchotière et une tourbière. Le climat y est difficile, avec des vents violents et des conditions souvent extrêmes. À Crozet, il est essentiel d’être en bonne condition physique. Pour l’anecdote, je me suis retrouvé plaqué contre un mur par une tempête alors que j'étais tout équipé pour affronter ces conditions. C’était un vrai défi physique et mental. À Kerguelen, le climat est également impitoyable, et les conditions de vie sont rudes, mais la beauté et l'isolement de l’endroit en font un lieu unique. J’ai eu l’occasion de rencontrer des personnes fascinantes, comme un Martiniquais qui faisait sa septième mission là-bas, un vrai passionné du froid. C’est ce genre d’expérience humaine qui rend ces endroits uniques.


Quel impact a ce type de voyage sur vous personnellement ?
C’est l’un des plus beaux voyages que j’ai faits. C’est un voyage au sens pur du terme, avec des rencontres humaines exceptionnelles, des paysages à couper le souffle, et une vie quotidienne qui est très différente de tout ce qu’on peut connaître ailleurs. Il n’y a rien de plus incroyable que de passer une nuit dans ces endroits reculés, sous des aurores boréales, avec une croix du sud visible dans un ciel sans pollution. C’est une expérience qui vous marque à vie.
Un dernier mot pour nos lecteurs passionnés par la recherche polaire ?
La recherche polaire est essentielle pour comprendre les grands enjeux globaux, qu’il s’agisse du climat, de la biodiversité, ou des équilibres marins. C’est une aventure humaine et scientifique qui mérite plus de reconnaissance. Si je peux inciter quelqu’un à s’intéresser à ce domaine, ce serait une belle victoire pour la recherche polaire. Et si vous êtes curieux, n’hésitez pas à suivre les missions, même de loin. Elles sont fascinantes.